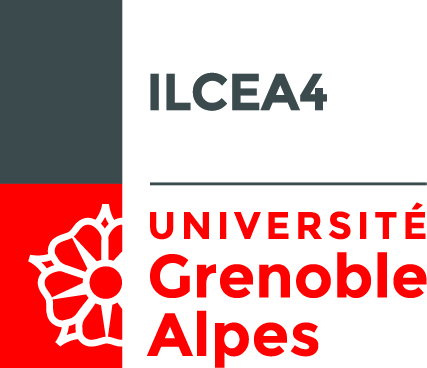Journée d'étude, Projection
Recherche
Le 1 avril 2016
Complément date

à partir de 15h00
Amphi 11 - bâtiment Stendhal
Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire
Complément lieu
Amphi 11 - bâtiment Stendhal
Cette manifestation, organisée par l’ILCEA4, a pour but de revenir sur les caractéristiques de cette opération ainsi que sur les problématiques liées à la mémoire, la recherche de la vérité et la justice dans le Cône Sud.
L’Amérique Latine dans son ensemble, et plus particulièrement les régions du Cône Sud et de l’Amérique Centrale, n’ont pas été épargnées par les traumatismes collectifs ayant marqué le XXe siècle. La vague répressive débutant à la fin des années 1960 dans le Cône Sud débouche, dans toute cette zone, sur la rupture formelle de l’ordre démocratique. Les coups d’État civil-militaires des années 1970 marquent le début d’une longue période dictatoriale caractérisée par la violation systématique des droits de l’Homme et la collaboration transnationale des Forces Armées.
Dans le cadre de la Doctrine de Sécurité Nationale, instrument de justification de l’application du terrorisme d’État dans la lutte contre « l’ennemi intérieur », la répression sera marquée par la mise en place d’un plan de collaboration répressive transnational de tous les régimes dictatoriaux alors en place : l’Opération Condor, officialisée en 1975. Les services secrets et les Forces Armées de l’Argentine, du Chili, du Paraguay, mais aussi de l’Uruguay, de la Bolivie, du Brésil puis de l’Équateur et du Pérou collaboreront activement dans la lutte contre les dissidents politiques potentiels et leurs proches au sein de leurs différents pays, en les poursuivant également aussi au-delà des frontières de l’espace latino-américain, en France, en Italie, au Portugal, en Espagne et aux États-Unis.
Le bilan de la répression pour le Cône Sud durant cette période est d’environ 50 000 personnes assassinées, 35 000 disparus, 400 000 prisonniers politiques, des centaines de cas d’enfants volés et confiés à des familles de militaires ou proches des régimes dictatoriaux. Ces atrocités conduiront des milliers de citoyens latino-américains à l’exil. C’est, entre autres pays, en France que beaucoup trouveront refuge : la construction de réseaux de solidarité conduira un grand nombre de Chiliens, mais aussi d’Argentins et d’Uruguayens en Isère. La charge traumatique individuelle et collective entourant ces événements leur donne une résonance sur le plan international.
Se rappeler ces événements traumatiques et poursuivre une réflexion quant à leurs échos et à leur gestion dans le présent, mais aussi quant aux enjeux politiques et sociaux entourant la recherche de la vérité et la poursuite de la justice constitue un devoir pour la communauté scientifique. Mais au-delà de la poursuite de cette réflexion intellectuelle, c’est aussi auprès de l’ensemble des citoyens que les enseignants-chercheurs ont un devoir : participer à la diffusion d’une recherche en sciences humaines autour de ces thèmes et soutenir les initiatives citoyennes qui naissent au niveau local fait en effet partie intégrante de leur responsabilité envers la société.
Parallèlement aux activités commémoratives liées aux 40 ans du coup d’État argentin de 1976 organisées par le collectif d’association grenoblois « Mémoire, Vérité et Justice », les chercheurs de l’axe civilisation hispanique de l’ILCEA4 dont les activités sont centrées sur les questions de gestion du passé traumatique, ont souhaité apporter leur pierre à cet édifice commémoratif en organisant un événement scientifique international autour des 40 ans du Plan Condor. L’Axe Civilisation Hispanique de l’Institut des Langues et Cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie mène depuis plusieurs années un projet-action autour de la mémoire des événements traumatisants et des relations internationales dans le monde hispanique.
Dans la continuité de ce projet-action, María Ferraro, Maître de Conférence en Littérature et civilisation latino-américaines et Lauriane Bouvet, doctorante contractuelle enseignante en civilisation latino-américaines, nous proposerons d’organiser dans un premier temps une journée d’étude internationale « A 40 años del Plan Condor », comptant sur la présence de chercheurs renommés et de témoins clés de l’Opération Condor et de la lutte pour la vérité et la justice qui l’a suivie.
Les interventions d’enseignants chercheurs et de témoins-clés de l’Opération Condor permettront lors de cette journée de poursuivre une réflexion sur les voies de gestion du passé traumatique. Après l’ouverture de cette journée d’étude par Almudena Delgado Larios et Marita Ferraro, Franck Gaudichaud (UGA, ILCEA4) réalisera d’abord un bilan historiographique critique des études consacrées au Plan Condor, et analysera le fonctionnement et l’impact, jusqu’à nos jours, du terrorisme d’État transnational afin de voir en quoi celui-ci a marqué un tournant dans l’histoire sud-américaine.
Ensuite, Lauriane Bouvet (UGA, ILCEA4) reviendra sur les voies de gestions mémorielles et judiciaires du passé traumatique dans le Cône Sud avant d’analyser brièvement deux expériences en cours de Procès du Plan Condor (Rome et Buenos Aires) afin de voir en quoi elles sont révélatrices de la dette qu’entretiennent les pays du Cône Sud en matière de justice, une trentaine d’années après le rétablissement de la démocratie.
Raul Olivera, coordinateur exécutif de l’Observatoire Luz Ibarburu, reviendra plus particulièrement sur l’expérience particulière de l’Uruguay en termes de justice quant aux crimes du terrorisme d’État.
A partir de leurs expériences personnelles en tant que victimes du Plan Condor, Sara Méndez et Macarena Gelman proposeront une réflexion autour du rôle du témoignage des victimes dans la construction de la mémoire et le processus de justice. Héctor Cardozo, de l’Association ¿Donde Están? et Magdalena Schelotto (Université Paris Descartes), croiseront enfin leurs regards d’activiste et de chercheurs afin de revenir sur la construction de la notion de victime du terrorisme d’État.
Pour terminer cette journée, l’intervention d’Olga Lobo (UGA, ILCEA4) précèdera la projection du documentaire « Nuestros desaparecidos » (Juan Mandelbaum, 2008) pour proposer une réflexion sur l’évolution de la construction de la mémoire du passé traumatique dans la production du cinéma documentaire du Cône Sud.
Contacts :
maria.ferraro univ-grenoble-alpes.fr
univ-grenoble-alpes.fr
lauriane.bouvet univ-grenoble-alpes.fr
univ-grenoble-alpes.fr
Cette journée d’étude fait partie de la programmation de la saison « Argentine 1976-2016/ Résistances, Mémoire, Justice, Démocratie », dont le point d’orgue sera la venue des Grand-Mères de la Place de Mai le 31 mars à l’Hôtel de Ville de Grenoble.
Programme complet de toutes les manifestations à consulter ici.
Une saison exceptionnelle co-organisée avec le Collectif Mémoire-Vérité-Justice-Rhône-Alpes, réunissant onze associations, et de nombreux acteurs culturels grenoblois.
Maria Osorio Ferraro
Info+
Lieu :
Amphi 11
Université Grenoble Alpes
Plan d'accès

 univ-grenoble-alpes.fr), Marianne Beraud (marianne.beraud
univ-grenoble-alpes.fr), Marianne Beraud (marianne.beraud univ-grenoble-alpes.fr), Christophe Caix (christophe.caix
univ-grenoble-alpes.fr), Christophe Caix (christophe.caix orange.fr), Federica Greco (federica.greco
orange.fr), Federica Greco (federica.greco univ-grenoble-alpes.fr)
univ-grenoble-alpes.fr)