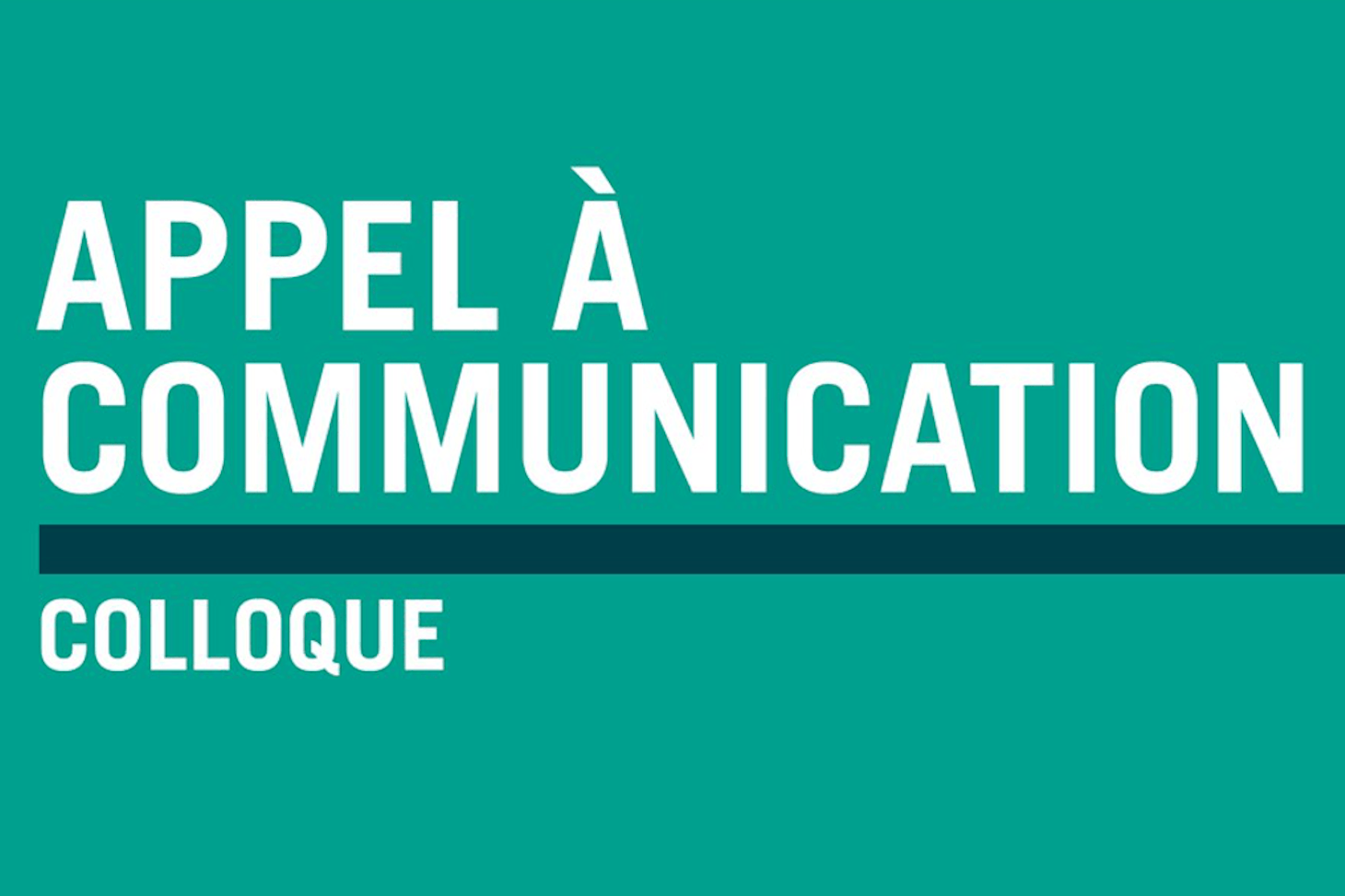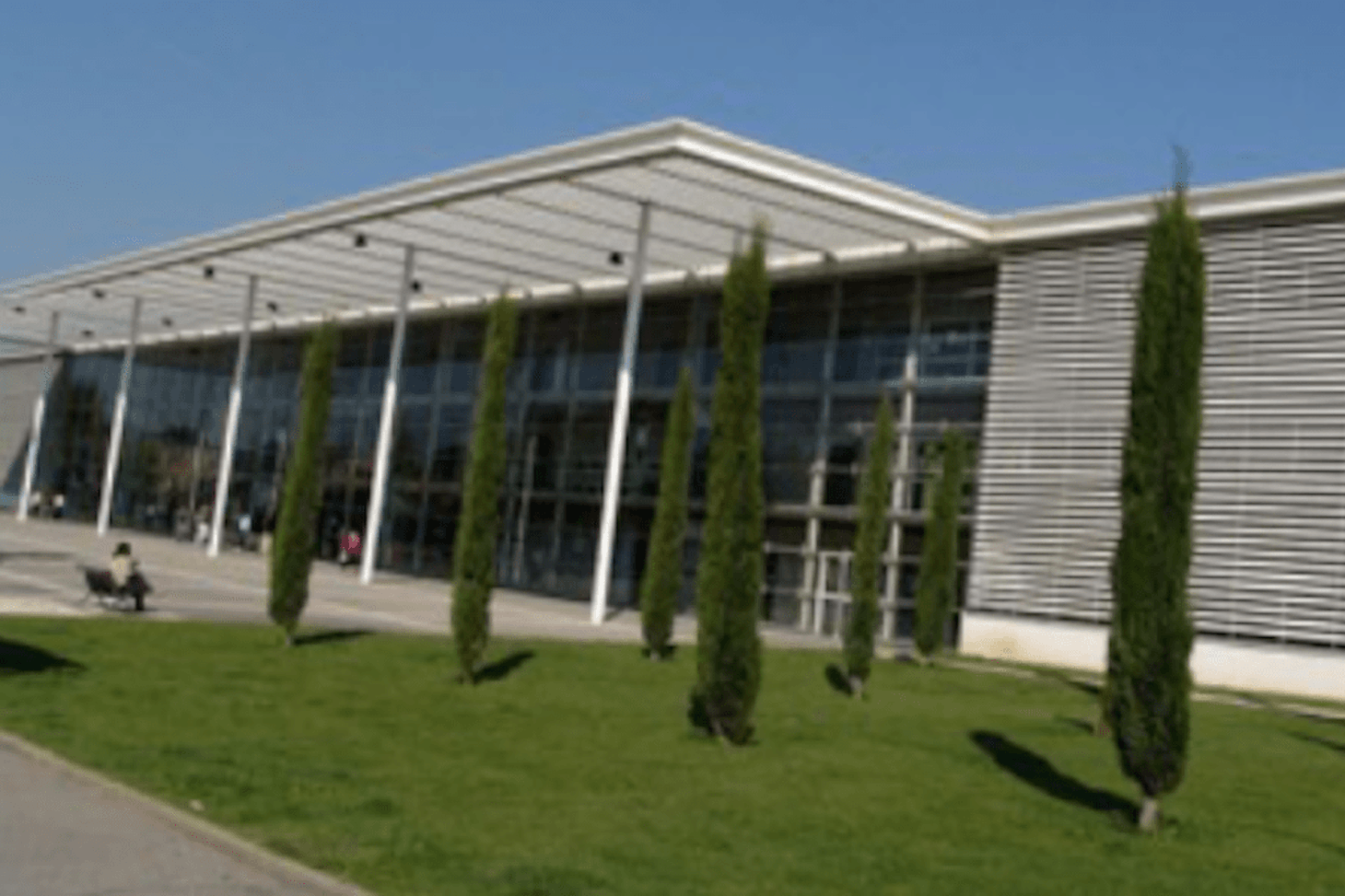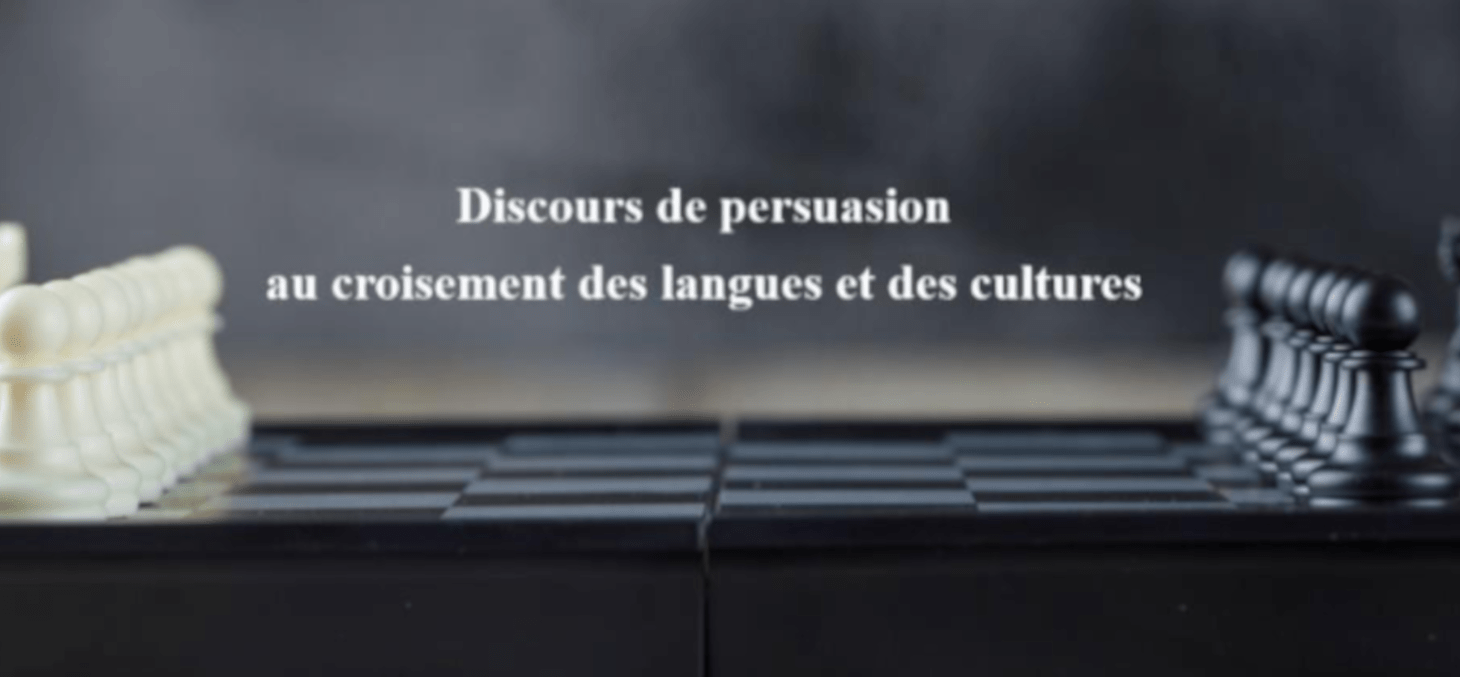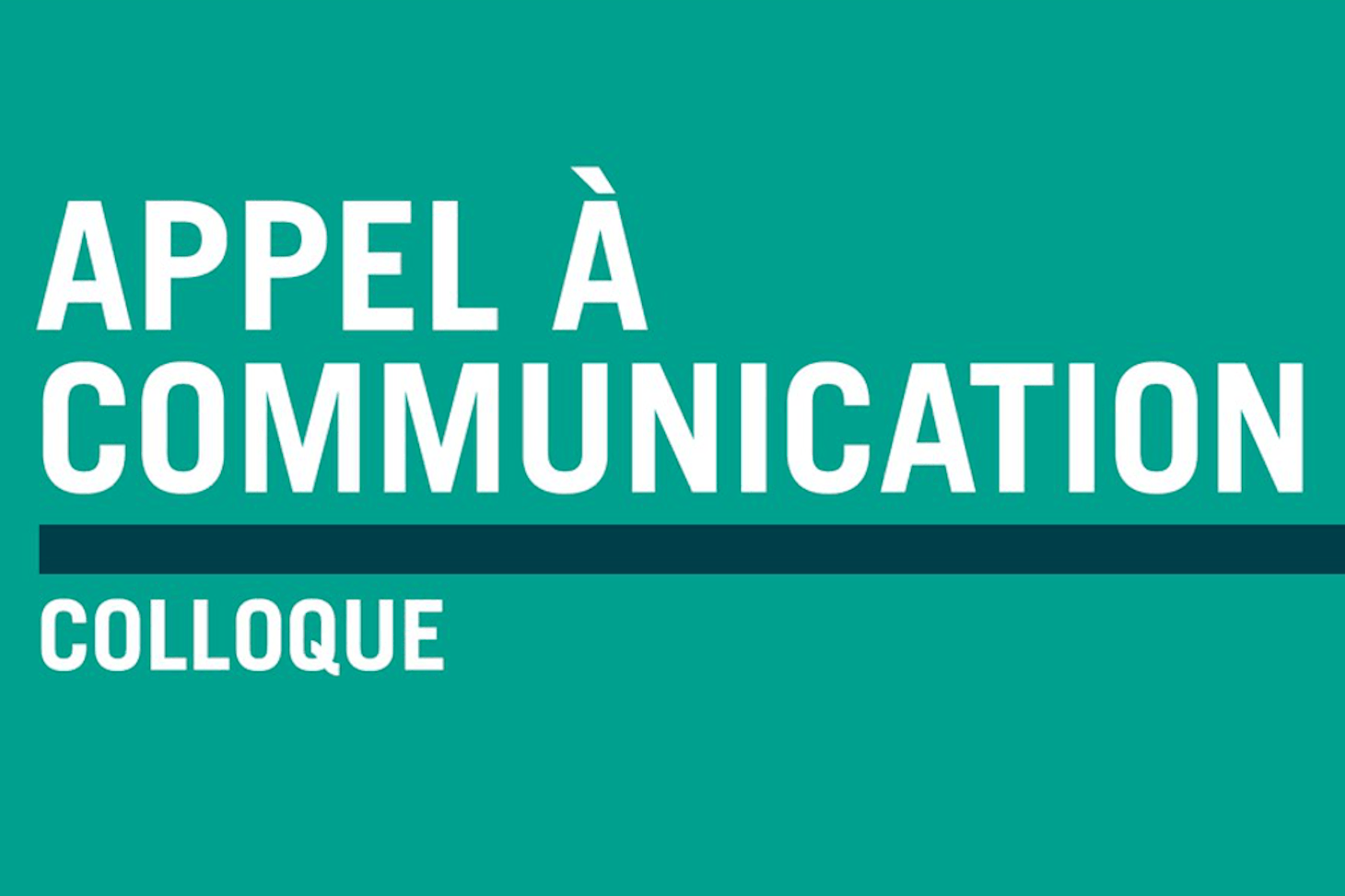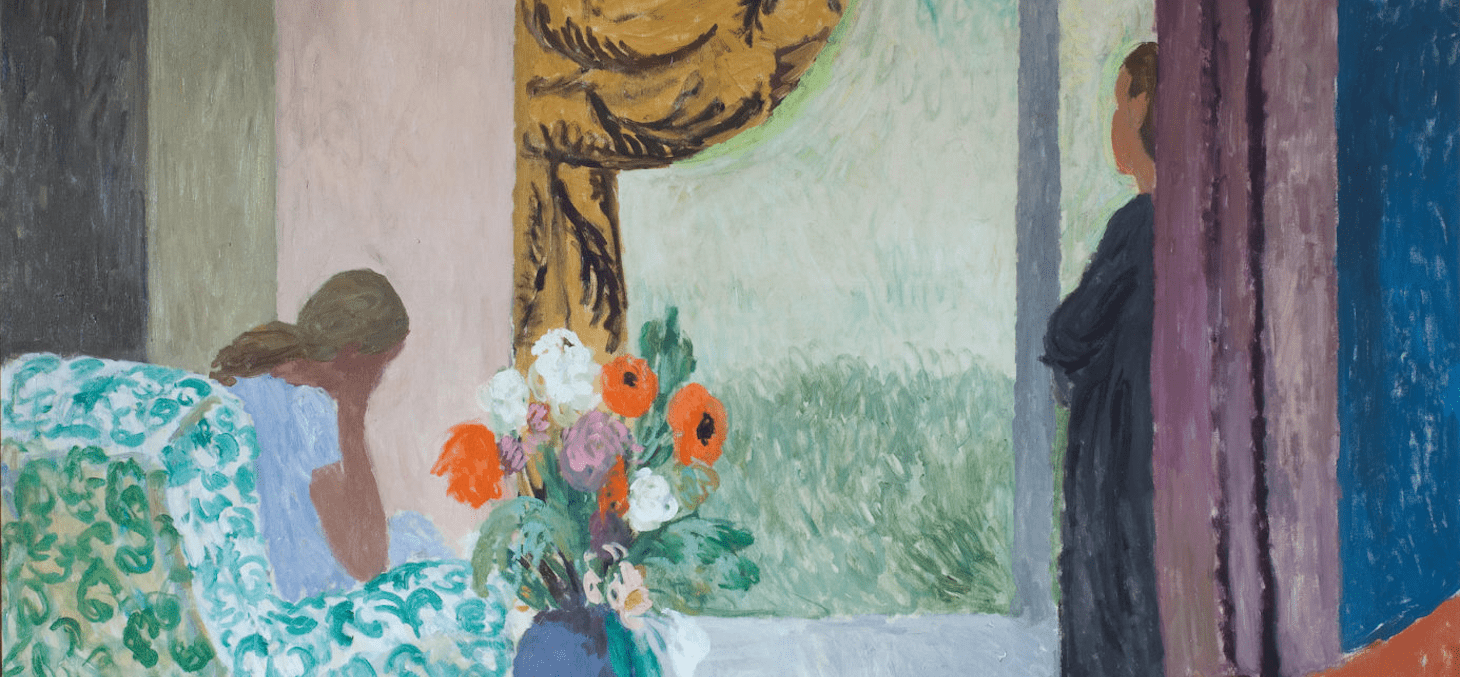Le champ d'interprétation du thème « Migrations » pour le congrès SOFEIR 2024 est délibérément large, puisque l'objectif est de faire une sorte d’état des lieux de la recherche universitaire en histoire et dans les sciences sociales, dans la littérature et les arts concernant non seulement les déplacements de personnes, mais aussi les échanges d'idées, d'objets matériels ou de marchandises, les échanges linguistiques à travers les siècles depuis et vers l'Irlande.
Alors que l'Irlande a été considérée au fil des siècles comme une terre d'émigration, les Irlandais fuyant le pays pour diverses raisons, politiques, religieuses, économiques ou culturelles, l’Irlande a connu au cours des trois dernières décennies des vagues d'immigration qui ont profondément transformé son paysage sociologique ainsi que son organisation et ses modèles religieux, politiques et linguistiques traditionnels. Le thème « migrations » pourra donc également inclure la notion de transferts sociaux. Cette transformation relativement récente liée à ce que l'on appelle les années du Tigre Celtique en Irlande sera au centre de nos préoccupations, le présent congrès étant aussi l'occasion de revenir sur des moments antérieurs de l'histoire irlandaise où de nouvelles idées sont arrivées d'outre-mer, révolutions potentielles ou au contraire porteuses de multiples contraintes conservatrices.
Le congrès offrira donc aux participants l'occasion de s’interroger plus avant sur les vagues d'émigration depuis l'Irlande et les relations entre les Irlandais d'Irlande et celles et ceux qui font partie ou ont fait partie par le passé de la diaspora irlandaise en Europe ou à travers le monde. Les situations des migrant·es de retour pendant les années du Tigre celtique sont également au centre de nos préoccupations, tout comme les migrations depuis et au sein de l'Empire britannique ainsi que les échanges politiques, religieux, économiques, culturels et linguistiques entre l'Irlande et le reste du monde avant qu'ils ne soient connus sous le nom de « mondialisation ». Le congrès de 2024 devrait également être l'occasion de réfléchir aux situations complexes auxquelles font face les migrants en Irlande aujourd'hui, depuis leur arrivée sur le sol irlandais jusqu'au processus, souvent long, d’installation dans le pays, et de soulever la question des réseaux et des modes de vie de ces « nouveaux Irlandais » en Irlande en 2024, mais aussi la façon dont ils sont perçus et représentés dans la littérature et les arts.
Le thème des « migrations » pourra également être envisagé du point de vue du non-humain et soulever des questions sur la manière dont les espèces animales et végétales, y compris les semences par exemple, ont migré et sans doute muté au cours des siècles vers et depuis l'Irlande, mais aussi sur la manière dont les discours sur le non-humain ont évolué, du pastoral teinté de nostalgie aux questions écologiques urgentes du présent. Les migrations linguistiques pourront également être prises en compte et considérées en termes d'évolution et de transferts d'un groupe de locuteurs de la langue anglaise à un autre, mais aussi en termes des évolutions et des transferts possibles entre les différentes langues parlées en Irlande et en traduction. D'un point de vue littéraire et artistique, nous souhaitons également encourager les communications sur les écrits ou les productions artistiques qui représentent ou abordent d'une manière ou d'une autre les questions de migration, mais aussi nous pencher sur les sources et les archives telles que les journaux intimes, les écrits épistolaires de toute nature, qu'il s'agisse de versions imprimées traditionnelles ou de corpus littéraires et/ou linguistiques plus contemporains.
Pour résumer l'objectif du congrès SOFEIR 2024 sur les « Migrations », nous attendons des propositions abordant les sous-thèmes suivants :
- L'émigration au départ de Irlande : historiquement et dans le contexte plus récent de l'après Tigre Celtique
- L'immigration vers l’Irlande : depuis les années du Tigre Celtique, mais d'autres exemples d'immigration au fil du temps peuvent bien sûr être pris en compte
- Transferts sociaux au sein de la société irlandaise pendant et depuis le Tigre Celtique
- Les migrations depuis et au sein de l'Empire britannique
- Migrations et re-migrations post-coloniales
- L'Irlande mondialisée
- La diaspora
- Les « nouveaux Irlandais »
- réseaux et logistiques migratoires
- Genre et migration
- Migration des plantes, graines, migrations botaniques
- Évolutions et transferts linguistiques ; traduction
- Œuvres littéraires et représentations artistiques abordant le thème de la migration et des migrants en Irlande ou des Irlandais à l'étranger
- Journaux de vie, écrits épistolaires de toute nature
- Les migrations technologiques, des productions et communications imprimées aux productions et communications en ligne
Les résumés de 500 mots, ainsi que courte notice biographie doivent être envoyés,
avant le 15 octobre 2023, à :
Marie Mianowski (
marie.mianowski univ-grenoble-alpes.fr (marie[dot]mianowski[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)
univ-grenoble-alpes.fr (marie[dot]mianowski[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr))
Véronique Molinari (
veronique.molinari univ-grenoble-alpes.fr (veronique[dot]molinari[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)
univ-grenoble-alpes.fr (veronique[dot]molinari[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr))
Le colloque est organisé par l'Université Grenoble Alpes et se déroulera à la Maison de la Création et de l’Innovation (MaCI) sur le campus de l’Université Grenoble Alpes.