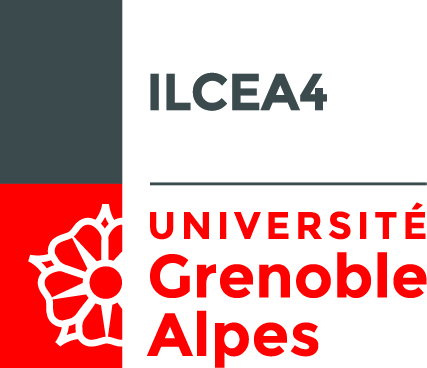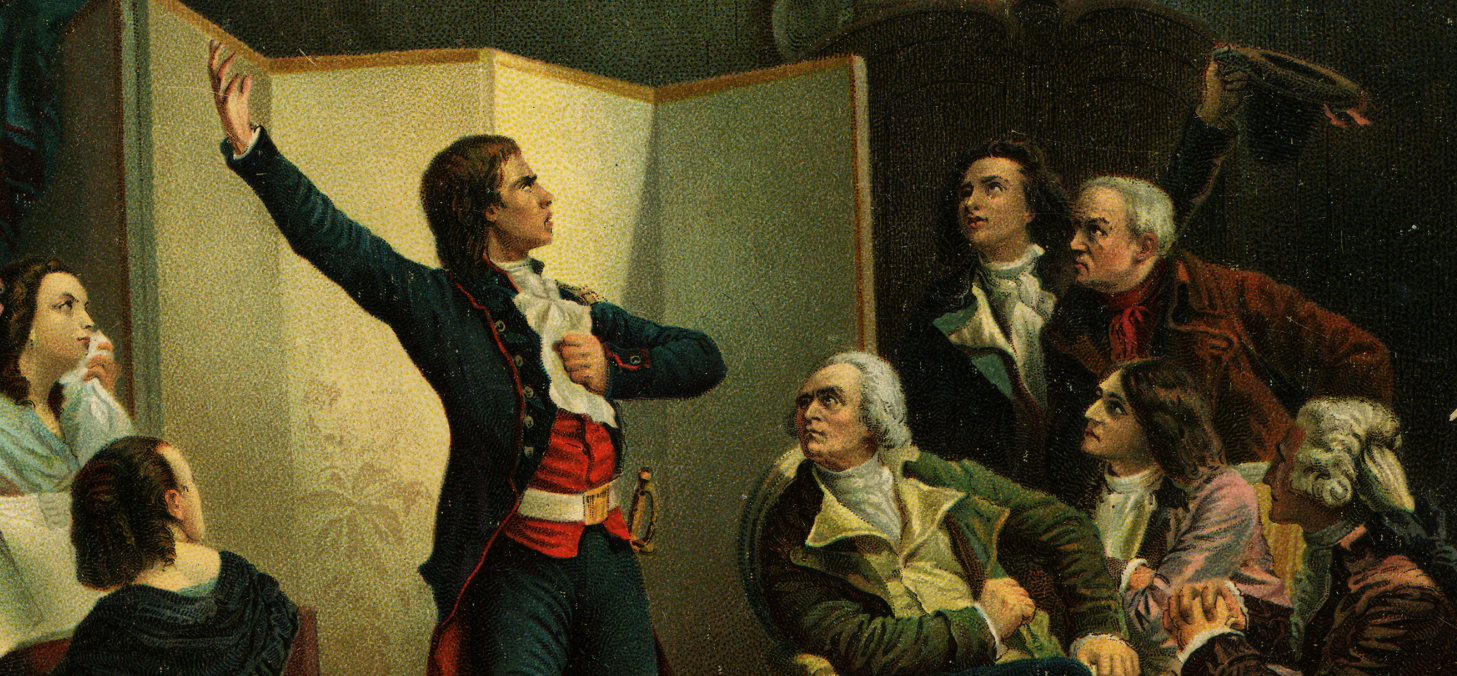Journée d'étude
Recherche
Du 28 juin 2018 au 29 juin 2018
Complément date
du 28 au 29 juin 2018
Salle Jacques Cartier - Maison des langues et des cultures
Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire
Complément lieu
du 28 au 29 juin 2018
Salle Jacques Cartier - Maison des langues et des cultures
Cette journée d'étude, qui réunit 18 chercheurs de Grenoble, Bordeaux, Lyon, Paris, Saint-Pétersbourg, Moscou et Macerata, est organisée dans le cadre de l'axe Discours, politique, innovation.
Dans son étude sur la littérature et l’engagement, Benoît Denis rappelle l’acception commune de l’expression « littérature engagée » : « En gros, chacun sait que l’expression "littérature engagée" désigne une pratique littéraire associée étroitement à la politique, aux débats qu’elle génère et aux combats qu’elle implique (un écrivain engagé, ce serait somme toute un auteur qui "fait de la politique" dans ses livres). » Explorant l’histoire de l’engagement dans la littérature française, il insiste sur le rôle joué par la Révolution de 1917 dans l’apparition de la littérature engagée au XXe siècle. Pour l’écrivain français, l’engagement politique correspond alors à un choix éthique en faveur d’une société présentée comme plus juste, car sans classes.
Dans la Russie soviétique, la Révolution a conduit à la mise en place d’un système qui a fait de la littérature une institution d’Etat, un des instruments de ce dernier pour forger l’homme nouveau et instaurer une société sans classes. Etre écrivain, c’était alors nécessairement être engagé dans la construction de la société communiste, par conviction ou par contrainte. Refuser cet engagement, c’était être condamné au silence. Mais c’est bien l’enjeu éthique d’une création poétique tournée vers la vie, soucieuse de créer du lien entre les hommes et les cultures qui justifie les œuvres qui ont survécu et accédé à l’universel, comme par exemple Requiem d’Anna Akhmatova. C’est dans ce sens que le titre de notre Journée d’études propose une réflexion sur les « voix littéraires » de l’éthique, puisque c’est la voix d’un narrateur, ou d’un sujet lyrique, qui est précisément la garante de la dignité humaine et de la relation entre les hommes. Comme le souligne Benoît Denis, « le refus de l’engagement est encore une forme de l’engagement, peut-être la plus authentique ». En effet, dans une seconde acception, l’engagement en littérature s’entend comme la défense de valeurs universelles, et implique alors parfois pour l’écrivain de prendre le risque de s’opposer au pouvoir. Ainsi, plus tard, les dissidents des années 1960-70, dans un autre contexte politique et social, ont prolongé ce même engagement contre un système politique inhumain, et cet engagement s’est généralisé dans les années 1980, où la dénonciation du mensonge et de la violence extrême du système soviétique est devenue un devoir moral pour des intellectuels qui retrouvaient ici la mission historique de l’intelligentsia du XIXe siècle...
Or, depuis les années 2000 et, surtout, 2010, en réaction, certains écrivains se font un devoir qu’ils présentent également comme éthique de réhabiliter le passé, ou du moins d’en nuancer l'appréciation, et de proposer une lecture de l'histoire récente où la Russie contemporaine serait la fière héritière d’une URSS héroïque. C’est par exemple le cas de Zakhar Prilepine, notamment dans ses essais. Ainsi la littérature russe rejoint-elle en partie la tendance à la nostalgie et à la mythologisation du passé qu'on observe dans les sphères politique et publique. Néanmoins, des auteurs comme Svetlana Aleksievitch, récent prix Nobel de littérature, poursuivent la dénonciation du passé soviétique. En littérature de jeunesse, plusieurs ouvrages récents (Olga Gromova, Sakharnyj rebionok, Olga Kolpakova, Polynnaïa iolka) donnent la parole aux victimes du système soviétique. Enfin, le désengagement de l'écrivain qui, comme Andreï Astvatsatourov de nos jours, choisit des thèmes intimistes ou privilégie le jeu avec les formes littéraires et l’intertextualité, peut se lire en creux comme une forme d'engagement – en faveur de la sphère privée ou individuelle, ou d’une conception de la littérature comme un domaine dépassant le seul champ du politique et obéissant à des règles intrinsèques.
Ainsi, avec la chute des régimes communistes, l’engagement en littérature cesse d’aller de soi en Russie et dans l’espace est-européen slavophone. Le questionnement éthique quant au rapport entretenu par la littérature en général et chaque écrivain en particulier avec la politique se pose avec une acuité renouvelée. Notre journée d’étude sera donc consacrée aux relations entre éthique, politique et littérature dans cette aire géographique et culturelle, depuis la fin du XXe siècle et la disparition des régimes communistes. Elle s’adresse plus particulièrement aux spécialistes en littérature contemporaine, mais aussi aux spécialistes d’autres périodes, qui sont invités à réfléchir sur le lien entre leurs domaines de recherches et le monde contemporain, notamment du point de vue de la lecture ou relecture de certains textes, ou bien à enrichir l’approche théorique du discours littéraire et de l’engagement politique en général.
Quelques pistes peuvent être esquissées par les questions suivantes : comment les écrivains contemporains inscrivent-ils le politique dans leur création ? Les genres privilégiés de l’engagement sont-ils toujours ceux que dégageait Denis Benoît (théâtre, roman, essai, pamphlet et manifeste) ? Quelles évolutions a connu le concept d’engagement depuis les années 1990 ? Entre engagement au profit d’une cause politique et refus de l’engagement politique au nom de valeurs individuelles ou spirituelles, les écrivains inventent-ils aujourd’hui de nouvelles formes d’engagement ? Quelle est la place des éditeurs et de la réception (par les critiques professionnels et par les lecteurs) dans ces évolutions ?
Il s’agira ainsi, d’une part, d’étudier la nature des questionnements éthiques qui se font jour à l’époque contemporaine et, d’autre part, de voir comment l’engagement éthique façonne la poétique des discours littéraires contemporains.
Isabelle Despres
isabelle.despres [at] univ-grenoble-alpes.fr

Contact
laure.thibonnier univ-grenoble-alpes.fr (Laure Thibonnier)
univ-grenoble-alpes.fr (Laure Thibonnier)
Infos+
Lieu :
Salle Jacques Cartier
Maison des langues et des cultures
Université Grenoble Alpes